« La plume fantôme»
Préface à Danser au bord du monde
d’Ursula K. Le Guin
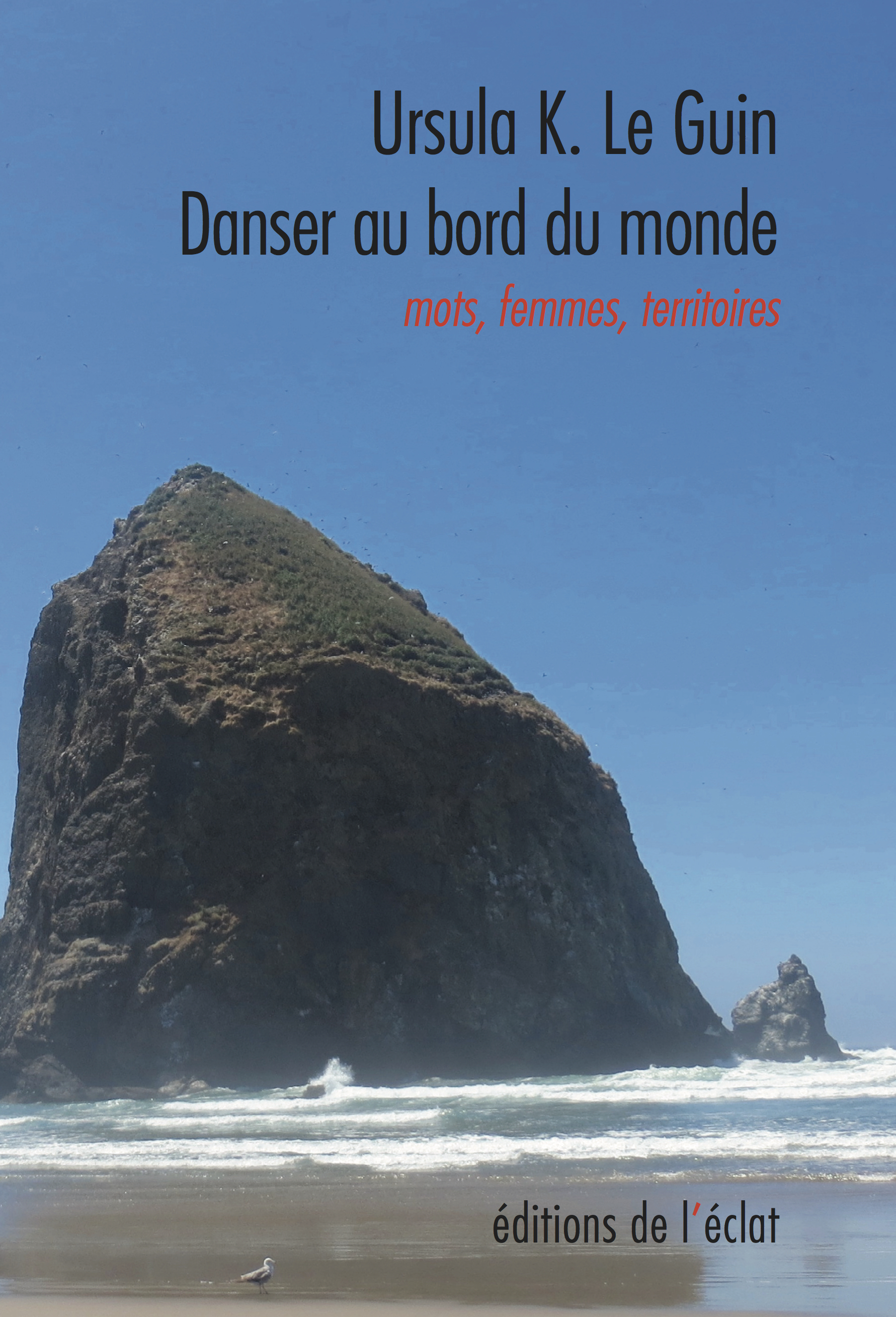
Qu’y a-t-il de l’autre côté de ton rêve Ursula? et sur l’autre bord de ce monde où tu danses? mais est-ce bien toi qui danses? ou, comme souvent, t’es-tu dissoute dans tes personnages? Et qui est Ursula? Une femme, un écrivain, une voyante, une écriture unique?
Peut-être le seul exemple en ce monde d’une écriture taoïste et bisexuée?
C’est une femme qui écrit, mais celle qui écrit n’a-t-elle pas, comme les personnages de La Main gauche de la nuit, une fâcheuse tendance à se projeter dans les deux genres à notre disposition, quitte à en créer un troisième, un ambigenre? Un être qui danse d’un sexe à l’autre, sorte de réalisation parfaite d’un tao anthropomorphe. Déjà Héraclite parlait des contraires comme étant indissolublement en contact, et toi, tu réconcilies les Sages présocratiques et Lao Tseu. Tout n’est-il pas en contact? Tout n’est-il pas mouvant dans le Tao?
Et Héraclite aussi: metabállon anapaúetai: « Changeant, il repose. »
Et ton mouvement est incessant, souple comme celui de la méduse qui ouvre The Lathe of Heaven, « entraînée de nulle-part en nulle-part, là où parvient la lumière et commencent les ténèbres ».
Le nulle-part, tu lui as donné des noms, tu en as établi les cartes, et tu as inventé ses légendes, ses peuples, ses coutumes. Ses territoires sans matière. Des bords de mondes inventés, des falaises posées sur la brume, des îles où passent les morts.
Tu es née et tu as vécu dans un monde perdu. Dont les habitants ne sont que des avatars. Inadaptés, somnambuliques. Des destructeurs de mondes et des bâtisseurs de tours. Des tours si hautes que pour les bâtir il a fallu faire appel à ceux du monde perdu, à ceux qui dansent au bord, qui ne connaissent pas le vertige. Ceux-là, tu les as appelés « oncle, tante, frère, sœur ». On t’imagine très bien enfant, apprenant les légendes à même les strates de terre rouge de la Californie, écoutant les paroles de celui que tu appelais oncle, et qui ne buvait pas d’alcool sur sa véranda après l’office du dimanche, mais savait construire un arc et parler aux ours. On t’imagine aussi déchiffrant tes propres strates.
Car ce que tu as écrit, tu n’as de cesse de l’interroger. Éternelle émigrée, s’excusant de son imperfection. Tu sembles dire: On m’a donné un monde, on l’a volé à des peuples, on les a appelés Indiens, puis Amérindiens, puis First Nations. Les noyant pêle-mêle dans un générique où, selon les besoins du message, on les montre tour à tour sages ou cruels. Et je ne serais pas en accord, en harmonie, en équilibre? Des mots importants pour toi. Équilibre, surtout. Alors tu reviens sur tes textes, tu t’excuses de n’avoir pas ceci ou d’avoir trop cela. C’est ta manière à toi de payer le tribut à ce monde d’avatars. Pourtant, chaque livre que tu as écrit est un reflet sur l’eau, aussi parfait, aussi mouvant, aussi équilibré, dispensant ombre et lumière dans l’élément liquide, révélant les mouvements dans la fixité des choses.
C’est de cette conscience d’appartenir à ce monde perdu, anéanti, dont les premiers habitants n’ont même plus de nom, que tu tires la matière de tes livres.
En nous racontant ces mondes au-delà des mondes, ces mondes au bord, ces mondes de forêts et de poussières, tu les racontes aussi à ceux-là, à ces peuples d’esprits et de fantômes, c’est pour elles et pour eux que tu inventes des fins décentes et des écoles où l’on n’apprend pas que les « Indiens ont cédé la place face à la marche du progrès ».
Et à te lire, une question revient: comment ai-je pu vivre toutes ces années sans connaître ces univers, alors que j’ai tant voyagé? Un de tes livres s’intitule Earthsea, « Terremer ». Avons-nous en effet besoin de plus? Tout ce qui se trouve dans la terre et sur la terre et tout ce qui se trouve dans la mer et sur la mer. Du feu aux abysses. Rien de trop. Mais justement l’homme blanc a un terrible et insurmontable besoin de ce trop. Il ne danse pas sur la terre, il l’avale. Y a-t-il un dieu plus proche des hommes blancs que Chronos? Et y a-t-il un concept plus fort pour l’homme blanc étasunien que le temps? N’est-ce pas ce que tu nous dis avec humour, lorsque tu nous parles de la ménopause, de la vieille dans l’espace et, à l’inverse, de ces rôles joués par la femme blanche étasunienne? Le temps de l’homme blanc avance corrode dévalorise. Le temps de l’Indien danse tourne oscille et apporte l’équilibre. Le temps de l’Indienne apporte les récits et les rires. Tu ne serais pas très à l’aise dans les nouveaux habits du féminisme, Ursula, d’ailleurs tu n’es à l’aise dans aucun uniforme, dans aucune panoplie. Cette Femme procédurière et triomphaliste, tu ne la connais pas. Féministe, c’est déjà accepter comme un fait évident que quelque chose nous lie et nous relie et nous définit, en tant que femmes, avec un tout petit f. Ni majuscules, ni terme générique se dressant devant l’Homme, exigeant l’égalité. Mais qui a envie d’être l’égale d’un footballeur, d’un marchand de canons, d’un chef suprême…? c’est sûrement pas nous. Un « quelque chose » a lié et défini les hommes et ce que ça a donné est invivable. Alors? Inverser les rôles, en jouant toujours la même pièce? les mêmes jeux de pouvoir? parler la langue paternelle en y ajoutant des e?
Dans « L’identité de genre ... », tu t’excuses d’avoir employé un genre pour un être qui en a deux. Quelle importance? Si j’avais la possibilité de changer de sexe plus souvent, je me ficherais pas mal qu’on m’affuble d’un e en plus, juste là, sur le papier. La belle affaire. Mais dis-moi, pour y revenir, cette vioque dans l’espace n’est-ce pas sur la terre que tu l’envoies, toi qui vis maintenant à Anarres? Une vieille à la peau sombre, à laquelle il manque une dent ou deux et couverte des cicatrices qui racontent tous ses rituels et son histoire. Parcheminée. Sage de la sagesse des ourses qui ont vu leurs petits finir en tapis. Sage de la sagesse de celles qui savent de source tarie que rien ne leur sera jamais acquis, jamais offert. Qui regardent tomber les arbres et les hommes, passer les saisons et les guerres, flétrir les légendes et les amours.
Sans étendard, Ursula, sans hurlements ni déferlements, tu nous parles de la terre et de la forêt, de leurs légendes et de leurs poésies. La violence tu ne la dissimules pas, mais tu ne la prends pas à ton compte. Tu nous parles de la mesure et du temps qui se creuse et ne fuit pas, du temps qui glisse lentement et ne se précipite pas, d’un temps vidé de la surabondance. Tu t’amuses à établir des cartes, quitte à les brouiller pour enrichir ton jeu. Alors oui, cette Crone, cette « vioque », cette sorcière, c’est sur la Terre que nous avons besoin d’elle, qu’elle nous raconte avec ta voix: la vanité qui éventre la terre, la couardise armée de fusils et de bombes, le mensonge disposant d’un empire de pixels et, trônant là-dessus, ton contraire, l’« écrivain qui a des couilles » comme tu dis, celui qui siffle alcool et belles poupées, assis sur une décharge, sous l’œil des caméras et des admirateurs-trices. Dans la lumière.
« L’ombre est une substance ayant son existence propre, dont la présence rend visible un monde qui serait sinon totalement noyé dans la lumière1. » Dans Les Tombeaux d’Atuan, une jeune prêtresse a été ensevelie vivante dans un labyrinthe absolument noir. Pas la moindre lueur, pas le moindre repère visible. J’ai longtemps été troublée par ces pages, peut-être les plus noires de toute l’histoire de la littérature. Littéralement. Pas de meurtres ni de cadavres, ni viols ni sacrifices humains. Le sacrifice de la lumière. Allégorie ironique d’une histoire de la féminité à ta façon? Noirs labyrinthes, tombeaux, vierge ensevelie dans des tunnels obscurs. La part d’ombre? L’Autre côté du rêve, encore un de tes titres en français. La Main gauche de la nuit? Nuit, rêve, autre côté, androgynes et dépossédés, un univers entier, le tien. Tu n’es pas un écrivain de science-fiction, mais une anthropologue des mondes qui s’inventent au cours de ton exploration. Et il est aussi possible que ce monde souterrain, obscur, indique une autre voie, celle du porc-épic par exemple, celle d’un monde où cheminer à reculons, où discerner plutôt que voir, où tâtonner plutôt que se précipiter, où murmurer plutôt que claironner. Et si nous acceptions d’être hérisson plutôt que léopard, scarabée plutôt qu’aigle royal? Avec de petites pattes et de petits yeux myopes. Creusant lentement notre chemin dans un désordre intelligent. Que se passerait-il? Il se passerait cette chose inouïe: nous n’aurions plus à choisir entre la liberté et le bonheur.
Isteddu, 8 octobre 2019
